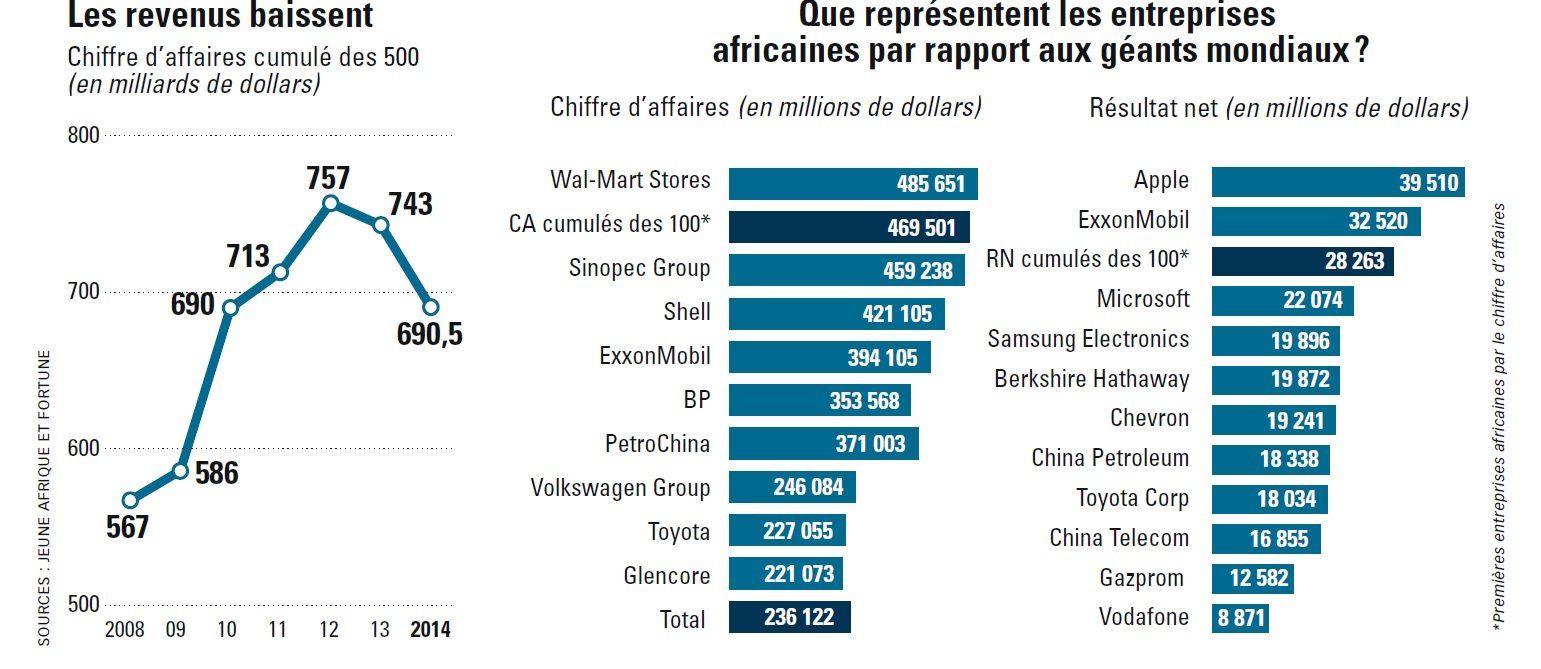Rebaptisons la COP 22 en Create Our Peace 22 car l’urgence c’est de réfléchir aux conditions d’une paix mondiale durable qui a la particularité d’être une problématique transversale à toutes les problématiques notamment celle du développement durable. Mais contrairement à tous les autres enjeux qui jusque-là ont mobilisé les leaders politiques mondiaux, l’enjeu d’une paix mondiale durable les obligera à une certaine déconstruction si tant est ils souhaitent vraiment cette paix! En fait, cette déconstruction fait appel à un changement de posture, de grille de lecture des rapports multilatéraux voire un changement tout simplement de paradigme. Il faut que les dirigeants sachent et acceptent que le monde a changé, change et continue de changer et les hommes aussi!!! Leurs paramètres d’analyse essentiellement basés sur un benchmarking entre puissances ne cessent de relever leur inopérance face à un homo novus, à l’ego surdimensionné, feignant d’être blasé ou il se trouve sur la planète. Comment en est-on arrivé là? Par les TIC à coup sûr, par ses multiples plateformes qui permettent les mises en scènes personnelles, concrétisent les aspirations à la célébrité même éphémère de Moussa, Jean, Daouda ou Fama.
En moins d’une trentaine d’années, les TIC participent au processus de dématérialisation du monde. La matière (puissance économique, militaire, etc.) qui jusque-là tenait le haut du pavé dans les relations multilatérales et entre les hommes perd insidieusement sa place au profit du monde immatériel celui des Idées. C’est le retour des idéologies me diriez-vous? Non, répondrai-je, c’est bien plus complexe que cela! A mon sens, il s’agit du retour de l’Homme, de sa volonté de recentrer le débat (et les projecteurs) sur lui aux fins de démontrer que la conscience humaine est un héritage commun quel que soit là où le hasard a bien voulu le placer. Cet homo novus sonne le glas aux monopoles, à tous les monopoles : monopole de la parole, de la mise en scène, des sensibilités. Malheureusement, le monde des idées est le lit aussi bien des bonnes idées que des mauvaises idées. Le meilleur legs aux générations futures est le retour aux principes universels de respect de l’Homme tout court, gage de paix (salam) et de sérénité. Cet appel à la paix est un appel à toutes les mamans. Nous voulons le meilleur monde pour nos enfants sortis de nos entrailles. Ils ne sont pas nés pour mourir bêtement!!!!









 Entité spatio-politique lilupitienne s’il en est une, la Gambie n’en reste pas moins un État à part entière reconnue par ses pairs. Incrustée dans le Sénégal, la Gambie partage avec lui un espace culturel quasi-identique. Avec une population d’1,9 million d’habitants, la Gambie se caractérise par un taux d’urbanisation assez élevé (plus de la moitié de sa population) et une économie portée par le tourisme
Entité spatio-politique lilupitienne s’il en est une, la Gambie n’en reste pas moins un État à part entière reconnue par ses pairs. Incrustée dans le Sénégal, la Gambie partage avec lui un espace culturel quasi-identique. Avec une population d’1,9 million d’habitants, la Gambie se caractérise par un taux d’urbanisation assez élevé (plus de la moitié de sa population) et une économie portée par le tourisme